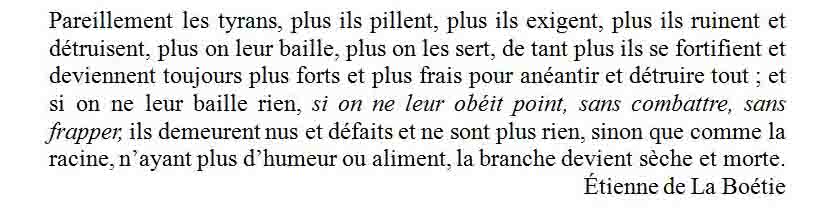David Graeber
Une fois de plus, ce livre (Possibilités) de David Graeber est un recueil d’articles (1. La hiérarchie… ; 2. L’idée même de consommation… ; 3. Les modes de production… ; 4. Le fétichisme…) ; articles dont le fil conducteur, nous semble-t-il, est énoncé dès la première page de l’introduction.
« Si j’ai été attiré par cette discipline [l’anthropologie], c’est parce qu’elle ouvre des fenêtres sur d’autres formes possibles d’existence humaine sociale, parce qu’elle peut servir à garder à l’esprit que la plupart des choses dont nous considérons qu’elles n’ont jamais évolué jusqu’à aujourd’hui, ont été, en d’autres temps et en d’autres lieux, configurées de manière complètement différente, et, par conséquent, que les possibilités humaines sont presque toujours plus grandes que celles que nous imaginons d’ordinaire. » [C’est nous qui soulignons.]
Recueil d’articles ? Cependant, il nous paraît que ces textes, dans un premier temps, ont été des cours universitaires (ou des prises de parole) pas toujours particulièrement construits et même avec des formes de redites ; la parole n’a pas la rigueur que devrait avoir l’écrit, mais s’il est acquis que nous n’écrivons pas comme nous parlons (et vice versa), mettre sur papier la parole présente quelques difficultés surtout quand s’accumulent un grand nombre d’informations et d’idées.
Ce qui n’empêche pas de la part de Graeber un grand questionnement tout azimut qui va de l’histoire à la philosophie.
Ethnographie comparée
Mais, si nous discernons un fil rouge, il en est d’autres plus ou moins indémêlables, parce que les fenêtres ouvertes par Graeber sont nombreuses ; il s’agit pour lui par une pratique d’« ethnographie comparée » de rassembler une série de points de vue, bien qu’« incommensurables », sur la réalité du monde et de dire les possibles qui se dérobent à la connaissance.
Ainsi va-t-il aborder des notions comme la hiérarchie, définie de plusieurs manières, interroger l’analyse des coutumes, des usages de déférence, d’évitement (faire disparaître « toute forme de reconnaissance des fonctions corporelles, excrétions, agressivité, etc. », usages de « plaisanteries » ; ainsi va-t-il réfléchir aux débuts de la propriété privée et de « l’individualisme commercial » qui vont donner naissance, de façons inégales, à une classe qui commencera « à intérioriser une logique d’exclusion ».
Ces notions, ces phénomènes, il semble que, jusqu’ici, selon Graeber, « les anthropologues aient manqué d’un langage pour les décrire » (p. 72).
Le rôle des puritains anglais est mis en avant quand il s’agit, pour des raisons de « discipline domestique », du salariat imposé aux « jeunes gens sans maîtres » jusqu’à ce qu’ils puissent, la trentaine atteinte, fonder une famille patriarcale. C’était sans compter sur des pratiques diverses de contestation, sur le carnaval renversant les hiérarchies et ouvrant l’imagination à l’idée de communautés d’égaux.
Consommation et destruction
Pour Graeber, il ne s’agit pas d’en rester à cette vision de l’économie politique qui s’en tient à deux sphères : la production et la consommation (et les échanges) ; la consommation étant d’abord une idéologie à analyser, une « force infinie » face à la vie sociale qui, elle, a toujours porté sur « la construction mutuelle d’être humains ».
Pourquoi mettre sur le même plan « manger de la nourriture » (détruire) et « regarder la télé » ?
Pourquoi appeler consommation certains comportements, « alors qu’il s’agit en réalité d’une forme créative d’expression de soi » qui implique la pratique d’un certain type de relations sociales (le potlatch) ?
Puis Graeber en vient, avec la théorie du désir au sens large, à distinguer les besoins, les envies, les intentions qui « impliquent nécessairement l’imagination » et l’invention des possibles.
Modes de production
L’idée de consommation est précédée dans la plupart des cas par le fait d’une production, maintenant essentiellement capitaliste. Ce chapitre est sous-titré par l’affirmation que « le capitalisme est une mutation de l’esclavage ».
Si les modes de production avaient été traités par l’analyse marxisante du capitalisme, Graeber, lui, voudrait porter son attention non sur les manières de fabriquer de la plus-value matérielle, mais sur « un façonnage mutuel des êtres humains » et examiner « les relations de service, les arrangements domestiques, les pratiques pédagogiques » et le flux des échanges, toutes pratiques qui maintiennent les sociétés en état de marche.
Il ajoute que ces taches sont effectuées à une écrasante majorité par les femmes et quelles ne sont pas considérées comme un travail.
La division traditionnelle entre infrastructure matérielle et superstructure idéale est vue comme une « forme perverse » de l’idéalisme, expression nuancée par l’affirmation que « la production du droit, de la poésie, etc. est aussi matérielle que toutes les autres.
« L’idée même qu’il existe des idées pures d’un côté et d’aveugles actions matérielles l’autre est une idéologie dont les opérations doivent être remises en cause. » (p. 192)
Fétichisme et créativité sociale
Que sont les fétiches ? Des objets impliqués dans les relations sociales, dans le commerce, dans les marchés ; ce sont des médiums, des témoins ; ce peut être n’importe quoi : un bout de bois, une queue d’animal, une pierre, une plume d’oiseau, etc., ou « quelque autre objet qui aurait le pouvoir de faire respecter leurs obligations communautaires, de punir ou au moins d’expulser ceux qui ne respecteraient pas le contrat social » (p. 268).
Car on peut donner à ses fétiches des intentions, un vouloir…
C’est en quelque sorte ce que nous faisons, sans trop y croire, quand nous avons un mouvement d’humeur contre l’ordinateur qui ne fonctionne pas à notre gré, quand nous insultons le vent qui nous incommode, quand on s’emporte contre un mimosa dont les racines ont abîmé les canalisations, etc.
« Le fétiche, selon William Pietz, écrit Graeber, est né dans un champ d’improvisation perpétuelle, c’est-à-dire de créativité sociale quasiment pure. » (p. 227)
« Les gens ‘‘fabriquaient’’ un fétiche comme moyen de créer de nouvelles responsabilités sociales, de conclure des contrats et des accords ou de former de nouvelles associations. » (p 228)
Si le fétiche est une création humaine, devant la complexité du monde il peut devenir comme une puissance étrangère. Le fétiche peut aussi se transformer en protecteur.
Sans être marxiste, Graeber reprend des analyses de Marx et ses travaux sur la valeur, sur l’argent comme moyen d’échange, et on tombe sur l’expression de « l’argent qui fuit » le marché capitaliste. Pour Graeber, « il faut savoir comment ces choses ont généralement tendance à fonctionner, quelle est la logique du système, comment les énergies humaines se mobilisent, s’organisent et, finalement, s’incarnent dans ces objets » (p. 285).
Le fétiche est une illusion.
« En fait, on pourrait même aller plus loin : il s’agit d’une illusion qui s’arrange pour tromper d’autant mieux ses victimes qu’elle les rassure en s’affichant comme illusion, ce qui revient à leur faire croire qu’elles ne s’illusionnent pas. » (p. 295)
En exemple des passages qui soulèvent des doutes tant dans la traduction que dans la correction du texte, nous donnons l’original de la phrase précédente ; cet exemple n’est pas isolé :
« En fait, on pourrait même aller plus loin : il s’agit d’une illusion qui s’arrange pour tromper d’autant mieux ses victimes qu’elles les rassure en s’affichant comme illusion, ce qui revient à leur faire croire qu’ils ne s’illusionnent pas. »Mais, quelle que soit la forme critiquable du livre de Graeber, le fond de son message demeure fort : nous pouvons, dès aujourd’hui, agir concrètement, nous engager physiquement au-delà d’un militantisme routinier, fade et satisfait, selon nous.
David Graeber, Possibilités.
Essais sur la hiérarchie, la rébellion et le désir,
Rivages poche, 2023, 412 p.
octobre 2024
֍