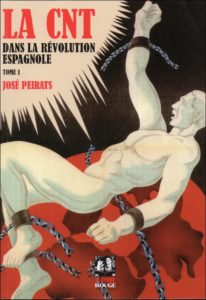
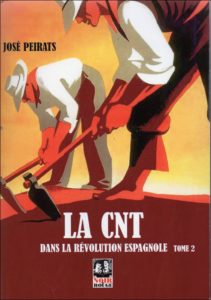
« La CNT
dans la révolution espagnole »,
de José Peirats
Volume 1
Les événements mémorables dont on ne rend pas compte, dont on ne parle pas, n’ont pas d’existence réelle, n’ont pas le droit de figurer dans l’Histoire ; c’est, au moins, soit de la simple négligence, soit, alors, a contrario, le dénigrement assuré. Ce fut le cas de la trajectoire de la Confédération nationale du travail, l’organisation anarcho-syndicaliste espagnole : la CNT ; ce déni s’est propagé après la victoire militaire des franquistes, puis après la Seconde Guerre mondiale et, de plus belle, avec l’omniprésence politique du marxisme autoritaire ; le tout en accord avec la bourgeoisie libérale et le capitalisme en expansion. On peut dire qu’il y a eu, là, une conspiration du silence qui, depuis quelques années, s’estompe lentement.
Il faut convenir que les principes de base et les buts de cette organisation allaient à l’encontre de nombre d’intérêts :
« La Confédération nationale du travail lutte pour la suppression du capitalisme et de l’État. Selon la CNT, l’État est par nature un organe d’oppression, de corruption et de privilèges. On entend par État tout organisme central de pouvoir inséparable d’un appareil répressif, militaire ou policier. »
Admirons donc, sans réticences, La CNT dans la révolution espagnole, œuvre de José Peirats, ouvrier briquetier, militant de cette CNT, devenu historien et qui, sans prétendre pour autant rester « glacialement objectif », a entrepris de faire l’historiographie de cette organisation. Il s’agissait pour lui d’aller « au-delà de la partie épique de la guerre civile et de l’hommage à la République trahie ». L’œuvre est largement lestée de nombre de documents.
Lors de l’établissement, en 1931, de la seconde République espagnole – Peirats titre « République de Casas Viejas », lieu d’un massacre demeuré célèbre –, c’est le monde ouvrier qui sera trahi par la bourgeoisie, par la gauche au pouvoir qui ne jure que d’instauration de lois diverses « encore à faire », et cela dans la crainte d’effrayer la droite et de provoquer une panique financière. Devant les tactiques d’action directe de la CNT, le gouvernement répond par des lois de « défense de la République » et par d’autres encore contre les « vagabonds et malfaiteurs », par des emprisonnements, des déportations, des « tirs sans sommation », etc.
Lors des élections de 1933, le gouvernement se droitise encore à cause de l’abstention des cénétistes qui proclament : « Face aux urnes, la révolution sociale », exhortation qui vit en effet de nombreuses tentatives révolutionnaires, d’ailleurs toutes vouées à l’échec ; et cela tout particulièrement en 1934, dans les Asturies, quand sous l’impulsion de l’UGT socialiste alliée d’un moment à la CNT s’engage une lutte qui sera matée par le Tercio (légion étrangère espagnole) et par les Regulares marocains.
La CNT gardera de cette époque en mémoire la répression exercée par le gouvernement socialiste et républicain et, en conséquence, affirmera que « la République, comme tous les régimes conservateurs et démocratiques, ne peut donner satisfaction aux nécessités et aux aspirations de la classe ouvrière ».
La question de voter, ou pas, va se reposer pour les élections de 1936. Question de tactique ou question de principe ? La discussion est débattue dans les syndicats. Pour certains, voter serait un moindre mal. D’autres sont partisans de l’action directe révolutionnaire et de la grève générale expropriatrice. Entre autres enjeux, la libération de 30 000 prisonniers politiques. Peirats écrit que la campagne antiélectorale d’alors fut « imperceptible par sa tiédeur ».
Les partis de gauche unis en un Front populaire sortirent de fait majoritaires de l’élection aux Cortès ; à quoi les militaires factieux allaient répondre par des tentatives de coup d’État. Il semblait bien que l’alternative se résumait entre le fascisme et la révolution sociale.
Le congrès de Saragosse de la CNT en mai 1936 fut l’occasion de donner, dans un texte de motion de grande qualité – tant dans l’énoncé des possibilités pratiques que par sa largeur d’esprit –, les grandes lignes de ce que serait la révolution à venir.
« La richesse étant socialisée, les organisations des producteurs, désormais libres, se chargeront de l’administration directe de la production et de la consommation. »
Cela tout en déclarant que, « pour la défense du nouveau régime social, l’unité d’action est indispensable » ; d’où un appel en direction de l’UGT mais aussi à ceux que l’on nomma les « trentistes ».
Un délégué de Pasajes, lors de son intervention, souligne de son côté que, « pour la révolution, il faut la convergence d’un ensemble de circonstances et que l’organisation soit prête. Nous avions comme facteur contraire cette masse des campagnes castillanes qui n’est pas gagnée à nos idées ; les Asturies qui ne faisaient pas contrepoids à l’influence socialiste ; le Pays basque non conquis ; une Andalousie et une Estrémadure avec de grands noyaux socialistes ».
C’est le 17 juillet 1936, dans la partie du Maroc colonisé, que débute le soulèvement fasciste, ce par l’occupation des ports, des aérodromes et des centres officiels et par le massacre d’ouvriers et de personnalités de gauche ; c’est l’œuvre du Tercio. Cependant que l’attitude générale des forces politiques républicaines, civiles et militaires, se caractérise par l’indécision et la plus grande méfiance à l’égard du peuple qui réclame des armes. Les faits cités par Peirats montrent que « le gouvernement de la République ne fit à peu près rien pour faire face à une si grave situation ».
De son côté, le 18 juillet 1936, le comité national de la CNT déclare la grève générale révolutionnaire ; c’est le début d’une contre-offensive ; le 20 juillet, le soulèvement factieux était maté en Catalogne. Dès lors, pour Peirats, militairement parlant, les fascistes avaient perdu la guerre : « L’Espagne antifasciste dominait les deux tiers du territoire national. » Il écrira pourtant, un peu plus loin, que « près de la moitié du pays gémissait sous les griffes du fascisme ».
Cela étant, à Barcelone, après la reddition de la caserne Atarazanas, la dernière à se rendre, des problèmes plus politiques vont se poser du fait que le mouvement anarchiste est le maître absolu de la situation ; ce que García Oliver résumera dans la formule : « Ou le communisme libertaire, ce qui équivaut à la dictature anarchiste, ou la démocratie, ce qui signifie la collaboration. »
Convoquées par Luis Companys, président de la généralité de Catalogne, « la CNT et la FAI optèrent pour la collaboration et la démocratie, en renonçant au totalitarisme révolutionnaire » ; ce que rapporte García Oliver, car, si la lutte était quasiment terminée dans Barcelone et sa région, on ne savait ni comment ni quand elle finirait dans le reste de l’Espagne.
« Revenus sur leurs lieux de travail, selon le désir exprimé par l’organisation confédérale […], les travailleurs d’un grand nombre d’entreprises constatèrent que la haute direction bourgeoise avait déserté ses postes de commandement » ; il en résulta que, sous le contrôle des syndicats, les travailleurs remirent en marche la production. Cette action se révélait plus délicate avec les entreprises à capital étranger ; aussi les syndicat observèrent-ils une « attitude modérée », selon la formule de Peirats.
Dans ces temps, composé de toutes les organisations de gauche, fut créé un Conseil de l’économie qui devait aider à résoudre ces problèmes et d’autres encore.
De même était créé un Comité central des milices antifascistes, en quelque sorte un gouvernement révolutionnaire, avec pour tâche, entre autres, le respect d’un certain ordre public, en particulier contre les pillages et les perquisitions abusives. Ce fut le travail des « patrouilles de contrôle ». Des militants éprouvés qui avaient désobéi aux directives de l’organisation syndicale furent même fusillés.
C’est alors que le gouvernement central de Madrid décréta la mobilisation des classes 1933, 1934 et 1935.
Aussitôt, à Barcelone, lors d’un grand meeting, les jeunes Catalans proclamèrent leur refus de retourner dans les casernes : « À bas l’armée ! Vivent les milices populaires ! » Oui au peuple en armes, car l’armée régulière est un danger pour le peuple. On arrivera cependant à une « solution de conciliation » en proposant que, dans les casernes, les mobilisés soient sous le contrôle d’un comité des milices.
Alfonso Miguel écrit en 1937 : « C’est ainsi que naquit en Espagne l’armée populaire et révolutionnaire, une nouvelle organisation militaire, forgée par un peuple antimilitariste et en pleine guerre contre ce qui avait été sa propre armée. »
Par ailleurs, l’UGT, refuge des attentistes, recrutait largement, notamment parmi la petite-bourgeoisie soucieuse de son avenir et aussi parmi tous ceux qui, comme les communistes, étaient en désaccord avec les libertaires ; tout comme le Parti socialiste unifié de Catalogne (PSUC) qui servira de tremplin pour arriver aux commandes de l’État.
Le 15 août 1936, Juan Peiró publiait un article dans Solidaridad Obrera, disant que le moment n’était pas propice « pour avancer des revendications prolétariennes de type social comme la réduction du temps de travail et l’augmentation des salaires ».
La volonté d’être réaliste, et de gagner la guerre, conduira dans la foulée à un compromis, sinon à une compromission, car après quelques tergiversations quatre libertaires entrèrent dans le Conseil national de défense, à Madrid, « bien qu’il ne fût au fond rien d’autre qu’un gouvernement sous un autre nom », nous dit Peirats. Dans Claridad, journal de Largo Caballero, président, on peut lire que la CNT faisait preuve de « bon sens et de maturité politique ».
Plus tard, dans Por qué perdimos la guerra, Santillán écrivit : « Nous savions qu’il n’était pas possible de faire triompher la révolution sans gagner la guerre et, à cause de la guerre, nous avons tout sacrifié. Nous avons sacrifié la révolution elle-même, sans remarquer que ce sacrifice impliquait aussi le sacrifice des objectifs de guerre. »
Le 3 septembre 1936 est publié dans Solidaridad Obrera un article d’André Prunier (André Prudhommeaux). Pour lui, « la guerre qui se poursuit en Espagne est une guerre sociale. L’importance d’un pouvoir modérateur, basé sur l’équilibre et la conservation des classes, ne saurait imposer une attitude définie dans cette lutte où l’État lui-même, dont les fondements vacillent, ne trouve aucune sécurité. Il est donc exact de dire que l’existence du gouvernement de Front populaire en Espagne n’est pas autre chose que le reflet d’un compromis entre la petite-bourgeoisie et le capitalisme international ».
« “L’État ouvrier” est le point final d’une action révolutionnaire et le commencement d’un nouvel esclavage politique. »
À Barcelone, l’apparition d’un conseil (gouvernement) de la Généralité entraînait la dissolution du Comité des milices – avec cependant une dualité persistante – qui vit l’arrivée de ceux que l’on nommait les « incontrôlés », ceux qui refusaient de se soumettre au nouveau pouvoir. Dans le reste de l’Espagne, d’autres conseils de défense s’installaient : en Aragon, aux Asturies, au Pays basque ; dans cette dernière région sans inclusion des libertaires.
Le 31 octobre, Juan Peiró renouvelle son appel à la collaboration avec les autres secteurs prolétariens ; il faut pactiser : « Qu’importe de transiger, si maintenant transiger est le seul moyen de triompher. » Et, toujours très « réaliste », il écrit que, quand la guerre sera finie, « le peuple se retrouvera face au maintien du régime de la propriété privée et du système capitaliste ».
Que pensaient de tout cela l’ensemble des cénétistes et autres libertaires ? Pour Peirats, « la triste vérité est que la plupart des militants étaient frappés par un certain fatalisme, conséquence directe des tragiques réalités de la guerre ».
C’est Sébastien Faure, dans Le Libertaire de juillet 1937, qui redéfinira l’« orthodoxie libertaire » ; cela en toute générosité et sans attaques personnelles, reconnaissant à chacun le droit à l’erreur. Pour lui, les règles d’organisation et les méthodes de combat doivent rester libertaires et on ne doit sous aucun prétexte abandonner la lutte de classe révolutionnaire et l’action directe.
Le 20 novembre 1936, à Madrid, c’est la mort de Durruti.
Pour autant, dans cette ville, « tous les fronts avaient été tenus, plusieurs mois durant, grâce à l’initiative du peuple et de ses milices ».
Les communistes, qui n’étaient au début des événements qu’un minuscule parti, se renforcèrent en s’infiltrant dans toutes les instances syndicales et gouvernementales ; commencèrent alors les agressions violentes contre la CNT : le transport de l’or espagnol vers la Russie fut le moyen par excellence du chantage communiste. Cet or, qui aurait pu servir à l’achat d’armement pour le front, servit largement à équiper les forces de police de l’arrière à la solde du gouvernement.
Solidaridad Obrera du 31 octobre 1936 rapporte : « Il existe encore une mentalité médiocre qui, fidèle aux positions antérieures au 19 juillet, tend de façon presque involontaire à reconstruire ce qui existait avant et qui a été détruit par la fatalité du processus révolutionnaire. »
Peirats consacre le chapitre XV aux collectivisations tout en décrivant ce qu’était l’économie espagnole avant le 19 juillet 1936, caractérisée par l’archaïsme, le caciquisme et la prolongation de la féodalité ; les secteurs innovateurs étant confiés au capitalisme étranger.
En Catalogne, c’est le 24 octobre qu’est décrétée la collectivisation des industries et commerces, de même que le contrôle des entreprises privées, légiférant par là un état de fait dû à l’action directe des travailleurs. Par ailleurs, Peirats dresse tout un panorama très détaillé, et d’une grande diversité, des collectivisations paysannes en Catalogne, bien sûr, mais aussi en Aragon, dans le Levant et en Castille. Nombre de ces collectivités furent détruites par la colonne Carlos Marx ou par la 11e division du communiste Enrique Lister.
En fait, la collectivisation ne fut pas absolue. « L’Espagne, déclare un militant, est un pays de petite-bourgeoisie et vouloir forcer ce sentiment peut entraîner des conséquences fatales pour la bonne marche de la révolution. »
Un autre travailleur, du secteur du bois, rappelle : « Ce fut là une lutte titanesque où il nous fallut batailler contre l’indifférence du peuple qui, devant l’ampleur de l’entreprise, nous traitait de fous. »
Volume 2
À Madrid, le peuple fut héroïque devant les militaires fascistes italiens et les nazis allemands, tout autant que devant les combattants maures. Peirats cite à l’appui de cette affirmation un texte des plus lyriques de Gonzalo de Repáraz publié dans Solidaridad Obrera du 13 janvier 1937. Au contraire des militants communistes, bien équipés par la Russie, les colonnes libertaires souffraient, elles, du manque d’armes. Ainsi les 3 000 combattants de la colonne España libre attendront-ils le 3 novembre pour partir en contre-offensive.
« La collaboration et la militarisation étaient les conditions préalables pour que soient satisfaites les demandes récurrentes d’armement et d’autres équipements », dit Peirats.
Victimes de la neutralité démocratique générale et de la « non-intervention », le peuple espagnol allait vers sa défaite face à un adversaire, lui, abondamment approvisionné en matériel de combat et en militaires par l’Italie et par l’Allemagne.
Un autre journaliste, Eduardo de Guzmán, écrit dans Madrid Rojo y Negro que « nombreux sont ceux qui, en dépit de leurs paroles, préféreraient perdre la guerre plutôt que de laisser la voie libre à la révolution en marche ».
L’anarcho-syndicaliste Cipriano Mera, de son côté, exigeait dans sa division une « discipline de fer ».
Cela dit, certains militants avançaient que « la socialisation, vu les circonstances dans lesquelles les industries opèrent actuellement, est irréalisable ».
Dans le chapitre XVII, Peirats rapporte nombre de comptes rendus de différents plénums ouvriers. Il s’agissait alors de commencer à organiser la production, qu’elle soit industrielle ou paysanne, et cela en s’efforçant d’unir UGT, CNT et également ceux que l’on nommait les rabassaires, des métayers viticulteurs, mais aussi de ne pas obliger à la collectivisation ceux qui souhaitaient continuer à produire en famille ; parmi les multiples difficultés, se révéla l’égoïsme inné de l’être humain, mais aussi un égoïsme « corporatif ».
Il s’agissait également, comme l’écrit Peirats, « de se prémunir contre les conflits possibles que causerait la juxtaposition de tant d’organisations nationales à côté de la Confédération nationale du travail ».
Début 1937, un grave incident éclata à Vilanesa à la suite d’un décret du ministre confédéral, Juan López, quand le gouvernement prit sous sa responsabilité l’exportation des oranges vers l’étranger ; la décision avait été adoptée sans consultation des paysans intéressés qui refusèrent d’appliquer les dispositions officielles ; le gouvernement envoya les gardes d’assaut. L’affaire s’apaisa après de violentes frictions répercutées par la presse soviétique qui en profita pour calomnier les anarchistes.
L’offensive antilibertaire était alors menée au grand jour, préfigurant les événements de mai 1937, car il était d’une grande évidence que, depuis le début de la tragédie espagnole, le Kremlin allait tout faire pour éliminer l’influence et les pratiques anarchistes. Pourtant, afin de « maintenir la fermeté du front antifasciste », des contacts furent établis entre communistes et cénétistes pour « éviter les débordements regrettables » ; entreprise vouée à l’échec : on découvrit des prisons clandestines mises en place par des « tchékas », des assassinats furent commis, et la presse soviétique continuait à déverser ses calomnies à jet continu.
De son côté, García Oliver, ministre de la Justice, s’efforçait « de rendre compatibles les conquêtes hardies du prolétariat avec la nature incompatible de l’État ». Des mesures comme l’union libre et l’avortement libre furent cependant mises en pratique.
C’est en 1932, à Madrid, qu’avait été créée le Fédération ibérique des jeunesses libertaires (FIJL). Si se diviser en vieux et jeunes avait été un débat, la divergence essentielle était ailleurs : les jeunes libertaires catalans se montraient plus radicaux et moins favorables à la collaboration, de même qu’à la militarisation. Néanmoins, c’est en Catalogne qu’eut lieu ce que Peirats nomme le « miracle de l’industrie de guerre ». Du jour au lendemain, des entreprises qui n’avaient jamais produit de matériel pour la lutte armée se convertirent : « Les usines qui produisaient du rouge à lèvres fabriquent aujourd’hui des cartouches et des balles », écrit Solidaridad Obrera. Ce qui n’empêcha pas les obstacles mis en place par le gouvernement de Madrid, ni la malveillance ni les diffamations des agents russes infiltrés.
Le 13 décembre 1937, Luis Companys adressait une très longue lettre à Indalecio Prieto, ministre de la Défense nationale, où il énumérait avec force détails l’effort industriel de la Catalogne pour s’équiper en matériel de guerre. Lettre qui ouvre nombre de réflexions sur la façon de gagner la guerre pour que triomphe la révolution libertaire, y compris en engageant des tractations avec les marchands d’armes internationaux.
Si la CNT avait été la première à essuyer les calomnies communistes, le Parti ouvrier d’unification marxiste (POUM) fut, lui, carrément mis hors la loi après les événements de mai 1937 (mais son élimination avait commencé dès décembre 1936). Puis, en mars, un décret du conseiller de l’Ordre public dissolvait les patrouilles de contrôle ; tout civil porteur d’une arme sans autorisation était désarmé et jugé : c’était là, pour notre auteur, une opération qui réduisait à l’impuissance un peuple sans armes.
C’est le 2 mai vers 15 heures que le central téléphonique (la Telefónica), occupé essentiellement par la CNT, mais aussi par l’UGT, fut attaqué sur commandement du conseiller à la Sécurité intérieure ; l’opération échoua grâce à l’intervention immédiate des confédérés des quartiers voisins. Mais c’était le début des événements tragiques de mai 1937. Le 5 de ce mois, le gouvernement catalan démissionna en bloc. Ce même jour, Camillo Berneri était assassiné par les communistes. Les forces policières profitaient de la moindre accalmie pour occuper des positions stratégiques. C’est pourtant à ce moment-là que la CNT et la FAI publièrent un communiqué où elles assuraient de nouveau que leur but n’était pas la prise du pouvoir politique et, de plus, que leur objectif, le communisme libertaire, n’était pas réalisable tout de suite. Elles rappelaient qu’elles avaient « accordé aux forces minoritaires la même proportion [que la leur] dans les postes de responsabilité publics ». Elles accusaient, sans le nommer, la volonté de dictature d’un parti. Cette attitude ne dura pas, et la politique du Parti communiste fut par la suite clairement dénoncée. Par ailleurs, il est avéré que certains indépendantistes catalans auraient bien aimé que les choses redeviennent comme avant.
Ces actions dramatiques firent, selon Peirats, 500 morts et 1000 blessés, sans compter diverses prises d’otages ; l’auteur ajoute qu’il « existe une abondante bibliographie sur l’aspect épisodique des tragiques événements de mai ».
Il écrit également que « la CNT a été dans toutes les étapes de la lutte espagnole la victime propitiatoire des manœuvres politiques ». « Le recours constant à la loyauté antifasciste, au sacrifice et à la tolérance était la meilleure preuve de son impuissance politique. »
La crise politique ne fit que s’aggraver par la reprise en main de l’ordre public par l’État, cela tant en Catalogne qu’au niveau national ; CNT et UGT furent de fait écartées du gouvernement.
S’appuyant sur un décret du 13 mai 1937 d’Ángel Galarza, ministre de l’Intérieur, Peirats écrit :
« Le ton draconien des textes transcrits est la meilleure démonstration de la psychologie de l’État. Tous les détails de langage, de style et d’intentions, caractéristiques de la forme historique du pouvoir politique, sont présents dans le texte. » Il continue en affirmant que « cette participation officielle de forces vierges ayant une popularité avérée au sein des masses, outre qu’elle n’a pas modifié cet organe permanent, a contribué, pour ne pas dire de façon décisive, à renforcer les institutions vacillantes et affaiblies du centralisme ».
Début juin 1937, en Catalogne, c’est Ricardo Burillo, « un communiste orthodoxe patenté », qui prend la tête des services de police.
C’est à cette période, lors d’un plénum réunissant la CNT, la FAI et la FIJL que s’amorça ce qui allait devenir le Mouvement libertaire espagnol (MLE) « qui allait survivre à la fin de la guerre pour se prolonger dans la clandestinité et l’exil ».
Le 18 juin, à Paris, un meeting au Vélodrome d’hiver fut l’occasion pour García Oliver, Federica Montseny et quelques autres militants espagnols de dire leur colère d’avoir été abandonnés par les prolétaires européens, dont les Français ; alors qu’ils réclamaient des armes, on leur envoya du chocolat et du lait concentré.
Le 29 juin 1937, la Confédération régionale du travail de Catalogne publiait un communiqué où on pouvait lire notamment :
« Depuis le mois de mai jusqu’à maintenant, les provocations contre la CNT en Catalogne n’ont pas cessé. On a persécuté les militants, on les a inculpés et assassinés ; on a fermé des locaux et détruit des collectivités ; on a multiplié les exactions pour pousser la Confédération régionale du travail de Catalogne à des retranchements désespérés. Néanmoins, face à la tourmente répressive et provocatrice, nous avons toujours conservé la même attitude sereine. Nous ne voulons pas déclencher une guerre fratricide et rompre le bloc antifasciste. »
Tout comme il était intervenu auparavant sur la FIJL, Peirats, dans le chapitre XXIV, revient sur la Fédération anarchiste ibérique (FAI), l’organisation spécifique anarchiste, créée en 1927, qui, pour gagner la guerre, avait accepté la collaboration et les relations avec des partis auxquels ils étaient opposés ; cela à cause « de l’état d’esprit du peuple qui demandait aussi qu’elles soient conservées ». Cette organisation, non reconnue par la loi, participa cependant – ô ironie de l’Histoire ! – aux organismes étatiques tout en n’étant pas un parti et en se transformant pour autant, dit Peirats, « en une sorte de parti politique » ; du moins, une organisation avec « une ligne identique englobant tous les aspects de la vie politique et sociale », précise un texte de la FAI, car il s’agissait « de présenter des solutions accessibles à la mentalité commune ». Lors d’un plénum début août 1937, à Barcelone, nombre de réactions contre cette évolution furent vives et négatives : on voyait là une position politique qui mettait en veilleuse les principes et tactiques de l’anarchisme.
(Rappelons que le groupe affinitaire, qui avait « été, durant plus de cinquante ans, l’organe le plus efficace de propagande, de relation et de pratique anarchiste », fut tout simplement annulé.)
C’est fin juillet que, comme l’écrit Peirats, se déclenchent les « préliminaires de l’offensive » lancée par le quotidien communiste Frente Rojo qui dénonce « les extrémistes, que certaines organisation protègent, en liaison étroite avec la cinquième colonne ».
Puis, le 11 août 1937, vint le décret de dissolution du conseil d’Aragon :
« Les nécessités morales et matérielles de la guerre exigent impérieusement de concentrer l’autorité de l’État […]. Le gouvernement estime, en se disposant à porter remède à la crise d’autorité qu’on remarque en Aragon, qu’il n’atteindra ses objectifs qu’en concentrant le pouvoir dans ses mains. »
Immédiatement après, la 11e division de Lister, la division Carlos Marx et la 30e division, commandée par des communistes et des séparatistes catalans, commencèrent à répandre la terreur à l’arrière du front en emprisonnant des libertaires et en détruisant des collectivités. Ce moment fut choisi alors que les cénétistes, provisoirement ravitaillés en armes et en munitions en quantité suffisante, lançaient une offensive triomphante, détournant leur attention de ce qui se passait à l’arrière.
La fin du tome 2 est consacrée à la crise du Parti socialiste et à celle de l’UGT, deux organisations dont le Parti communiste tente de s’emparer. Un très long discours de Largo Caballero au cinéma Pardiñas, le 17 octobre, donne son point de vue général sur l’ensemble des événements, discours publié quoique partiellement car mutilé par la censure du gouvernement auquel il appartenait quelque temps plus tôt. Quelques extraits :
« Cette crise a été provoquée par les représentants du Parti communiste au gouvernement. » « Vous savez qu’en Catalogne il y a ce qu’on appelle un Parti socialiste unifié, qui n’est pas un parti socialiste unifié, mais le Parti communiste catalan. » « Pour autant, suis-je anarchiste, comme certains le disent ? D’ailleurs, cela ne me déshonorerait pas. »
Malgré tout, « les ugétistes communisants avaient gagné la partie », écrit Peirats en terminant ce volume.
José Peirats, La CNT dans la révolution espagnole,
tome 1, 2017, 526 p., tome 2, 2019, 474 p.
Le tome 3, 520 p., 2020.
Noir et Rouge éditeur
♦
